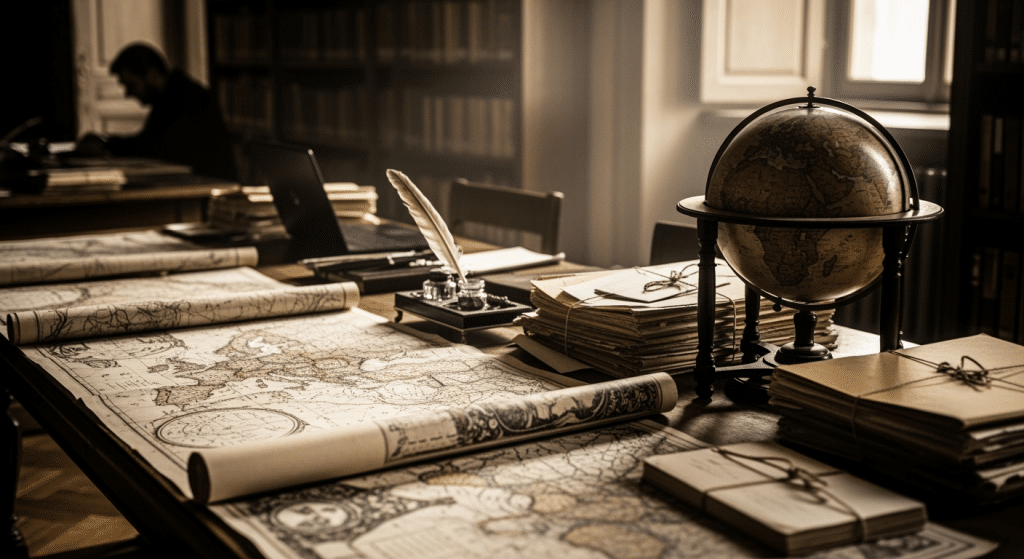ENTRETIEN. Fort de sa connaissance de la diplomatie des XVIe‑XVIIIe siècles, l’historien Lucien Bély rappelle les principes qui ont façonné l’art de la paix et interroge leur portée face aux fragilités contemporaines : montée des conflits hybrides, accélération de l’information et redéfinition des intérêts nationaux au sein de l’Europe.
Un héritage ancien toujours pertinent
Membre de l’Académie des sciences morales et politiques et spécialiste reconnu des relations internationales, Lucien Bély tire des travaux sur des figures comme Torcy, Vergennes ou Talleyrand plusieurs constantes : la défense des intérêts nationaux, la connaissance géopolitique des forces en présence, la négociation d’alliances et la capacité à rédiger des arguments publics ou secrets pour justifier les choix gouvernementaux. Ses ouvrages, dont L’Art de la paix en Europe (PUF, 2007), rappellent que la diplomatie est née d’une pratique politique qui vise à permettre la confrontation des puissances sans recours systématique à la force.
La paix en Europe, entre construction et fragilités
Pour Bély, la construction européenne a renforcé la paix par l’agrégation de démocraties, la coopération économique et culturelle, et des règles limitant officiellement les revendications territoriales. Mais cette mécanique engendre aussi une lenteur décisionnelle : le consensus nécessaire entre 27 États rend difficiles des réponses rapides aux crises. La guerre en Ukraine réactive par ailleurs la nécessité d’une Europe capable de se défendre face aux menaces multiformes, notamment russes.
Souveraineté partagée, souveraineté limitée
L’historien souligne le caractère particulier de la souveraineté européenne : les États conservent leur souveraineté mais délèguent certains pouvoirs (monnaie, normes, commerce) à des institutions communes. Cette souveraineté « limitée ou inachevée » produit une capacité d’action collective réelle mais contrainte, en particulier en matière de politique extérieure et de défense où l’absence d’armée commune reste un frein.
Temps, information et négociation
Bély rappelle le rôle décisif du facteur temps en diplomatie : savoir proposer ou temporiser au bon moment peut modifier le cours d’une négociation. Si la circulation accélérée de l’information permet des réactions plus rapides, elle n’assure pas pour autant des accords plus faciles. L’usure des belligérants demeure souvent le moteur des négociations sérieuses.
Technologies : outils et nouveaux défis
Les nouvelles technologies ont transformé le métier : contacts instantanés, visioconférences et visibilité accrue des chefs d’État. Elles facilitent le travail mais ouvrent aussi la diplomatie à la désinformation et à des acteurs non étatiques puissants. Le diplomate moderne doit combiner représentation, négociation, expertise technique et écoute des sociétés locales.
L’image du diplomate aujourd’hui
Si le cérémonial a longtemps alourdi l’image de l’ambassadeur, Bély rappelle que la fonction exige désormais une grande expertise et une exposition médiatique plus forte. L’ambassadeur défend les intérêts économiques et sécuritaires de son pays, protège ses concitoyens et doit être capable d’intervenir dans des contextes parfois dangereux. Le métier exige curiosité culturelle, discrétion et capacité à construire des passerelles entre sociétés.
En conclusion, l’héritage des diplomates d’Ancien Régime fournit encore des repères : défense des intérêts nationaux, maîtrise du temps diplomatique et prudence dans l’usage du secret. Mais le XXIe siècle impose des adaptations : coopération européenne renforcée, maîtrise des technologies et reconquête d’une capacité d’action internationale face aux menaces contemporaines.