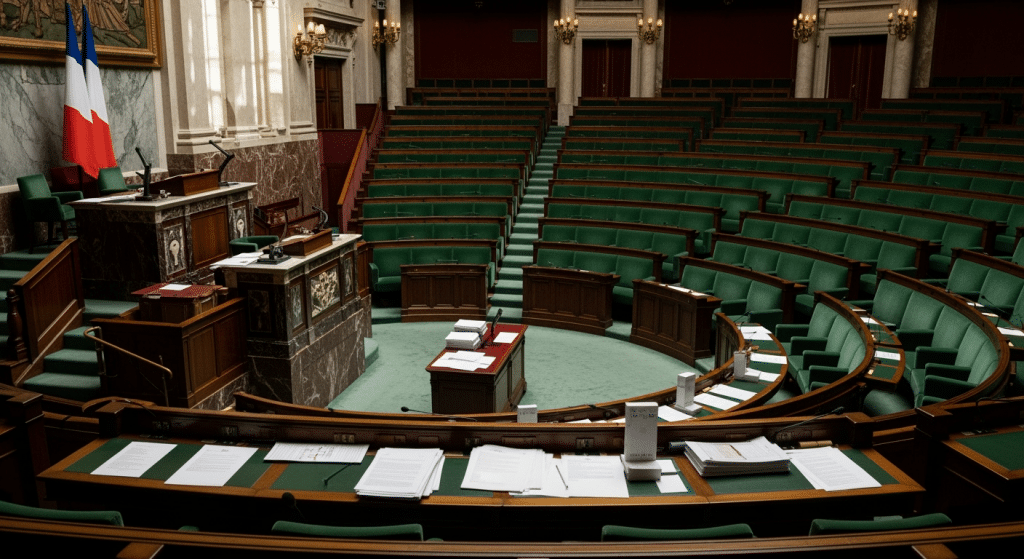Le coordinateur de La France insoumise, Manuel Bompard, a annoncé le 8 septembre que son groupe déposerait le 9 septembre une proposition visant la destitution du président de la République. L’initiative relance le débat public, mais la procédure prévue par la Constitution rend peu probable une issue favorable aux auteurs de la motion.
Un cadre constitutionnel très contraignant
L’article 68 de la Constitution prévoit la destitution «en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat». Ce dispositif, introduit en 2007 pour remplacer l’ancien régime de la « haute trahison », est volontairement encadré. Il vise à éviter que la destitution ne devienne un instrument de règlement politique courant.
Pour le constitutionnaliste Benjamin Morel, cité par la presse, l’intitulé de l’article laisse aux parlementaires la charge de définir les limites d’application. Mais, ajoute-t-il, la procédure elle-même fonctionne comme un garde-fou: «le bon usage de la motion n’est pas défini par un cadre juridique précis, mais par une procédure très contraignante», ce qui empêche selon lui qu’on «démôte un président pour tout et n’importe quoi».
Trois séries de votes et des obstacles institutionnels
- 1/10 de l’assemblée pour déposer la proposition : la proposition doit être motivée et signée par au moins un dixième des membres de l’assemblée d’origine (Assemblée nationale ou Sénat). Sur ce point, La France insoumise pourrait franchir l’étape: le groupe compte 71 députés, soit environ 12% de l’hémicycle.
- Contrôle du bureau et de la conférence des présidents : le bureau de l’Assemblée peut écarter d’office une proposition qui ne remplit pas les conditions de forme ou de fond. La conférence des présidents, qui fixe l’ordre du jour, peut également retarder ou refuser l’inscription à l’examen, faisant ainsi avorter la procédure avant même un vote de fond.
- Majorités qualifiées dans les deux chambres : si la proposition est inscrite, elle doit être adoptée par au moins deux tiers des députés de l’Assemblée puis, dans les quinze jours, par deux tiers des sénateurs. L’exigence d’un tel quorum rend l’aboutissement très difficile dans un Parlement divisé.
Si les deux assemblées approuvent la résolution, le dossier est transmis à la Haute Cour, composée des membres des deux chambres réunies. La Haute Cour dispose d’un mois pour se prononcer et la destitution requiert là encore une majorité des deux tiers. Les délégations de vote sont interdites et ne sont comptés que les suffrages favorables, renforçant le caractère exigeant de la procédure.
Conséquences et précédents
Pendant toute la durée de la procédure, le chef de l’Etat conserve l’exercice de ses fonctions. En cas d’adoption finale, le président est immédiatement démis, le président du Sénat assure l’intérim et une nouvelle élection présidentielle doit être organisée dans les 35 jours conformément à l’article 7 de la Constitution.
Dans les faits, depuis la révision constitutionnelle de 2007, aucune procédure de destitution n’a abouti. L’article 68 a été conçu comme une voie d’exception et, pour Benjamin Morel, il s’apparente à une «usine à gaz» : lourdement encadré et peu propice à un usage fréquent.
La France insoumise avait déjà tenté une procédure en 2024, après les élections législatives anticipées. La Commission des lois avait alors examiné la proposition, mais la conférence des présidents avait refusé de la porter à l’ordre du jour de l’hémicycle. L’exemple montre que, au-delà du signal politique, la trajectoire constitutionnelle reste semée d’obstacles institutionnels.
Un geste politique plus qu’une issue probable
Du côté des initiateurs, la motion vise d’abord à «débloquer la situation» politique et à mettre la pression sur l’exécutif. Sur le plan strictement constitutionnel et procédural, en revanche, il est peu probable qu’une motion de destitution aboutisse dans les semaines à venir. Entre l’exigence des signatures, le rôle restrictif des instances de l’Assemblée et les majorités qualifiées nécessaires, la procédure reste conçue pour n’être utilisée qu’en last resort.
Reste que, même sans perspective d’aboutissement, le dépôt d’une motion produit déjà des effets politiques: il cristallise les tensions, alimente le débat public et oblige les forces politiques à se positionner publiquement sur la responsabilité du chef de l’Etat.