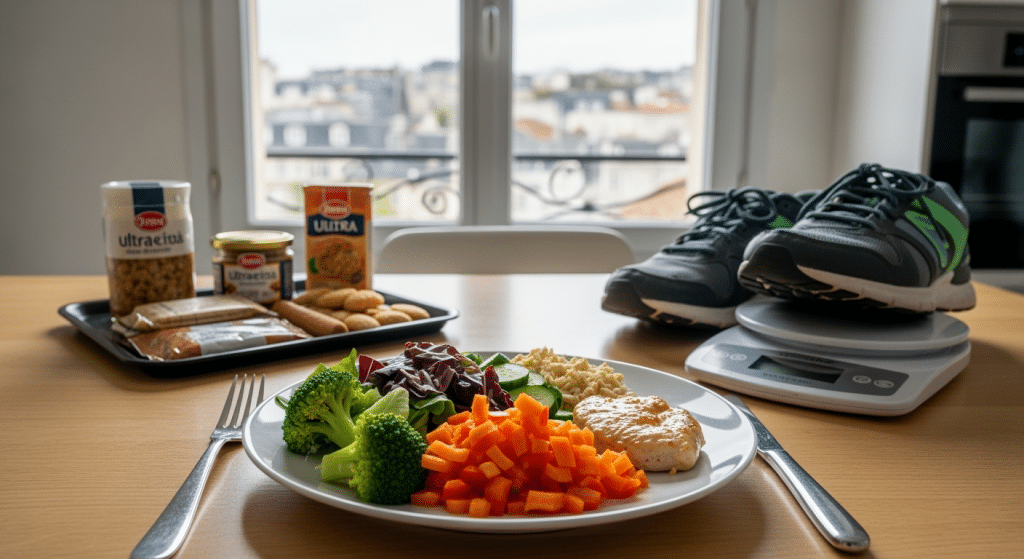La perte de poids n’est pas qu’une histoire de volonté. Repris d’un article initialement publié sur The Conversation par la chercheuse Rachel Woods, cet état des lieux rappelle que la lutte contre le surpoids et l’obésité relève d’une combinaison complexe de facteurs biologiques, sociaux et environnementaux, en France comme ailleurs.
1. Notre biologie s’oppose souvent à la perte de poids
Les mécanismes physiologiques favorisent le stockage de l’énergie. Face à une restriction calorique, le métabolisme s’ajuste à la baisse et des hormones de la faim, comme la ghréline, augmentent. Ces processus — hérités de notre passé évolutif — rendent la perte de poids durable difficile. En France, la prévalence de l’excès de poids était estimée à 47,3 % en 2020, dont 17 % en situation d’obésité, signe que les politiques centrées uniquement sur la responsabilité individuelle peinent à inverser la tendance.
2. Ce n’est pas une question de volonté
La génétique influence la vitesse de dépense énergétique, la sensation de faim et la satiété : certaines personnes héritent d’une prédisposition qui complique la gestion du poids. À cela s’ajoutent des déterminants sociaux — accès à des aliments sains et abordables, temps disponible pour cuisiner, possibilités d’activité physique, qualité du sommeil, niveau de stress — qui varient fortement selon les territoires et les conditions de vie.
3. Les calories ne font pas tout
Si le principe d’un déficit calorique est central, la réalité est plus nuancée. L’étiquetage nutritionnel donne des estimations et l’énergie réellement absorbée dépend de la cuisson, de la digestion et du microbiote intestinal. Par ailleurs, deux aliments apportant le même nombre de calories n’auront pas le même effet sur la faim ou la satiété : un œuf procure une satiété durable, tandis qu’un biscuit peut entraîner des pics glycémiques et une reprise de l’appétit.
4. L’exercice est bon pour la santé, mais pas magique pour maigrir
L’activité physique améliore la santé cardiovasculaire, la force musculaire et le bien-être mental, mais elle n’entraîne pas systématiquement une baisse significative du poids. Le corps compense parfois les dépenses supplémentaires par une activité moindre le reste de la journée ou une augmentation de l’appétit. Cela ne minimise pas l’intérêt du sport : ses bénéfices dépassent largement la seule mesure sur la balance.
5. Améliorer sa santé ne passe pas toujours par la balance
Des améliorations de l’alimentation (qualité des aliments plutôt que restriction extrême), une activité physique régulière, un meilleur sommeil et une bonne gestion du stress peuvent faire chuter le cholestérol, la tension et améliorer la glycémie, même si le poids ne change pas notablement. Pour de nombreux patients, se concentrer sur ces indicateurs de santé est plus pertinent que viser un chiffre précis sur la balance.
En pratique, ces constats invitent à repenser les messages de santé publique : plutôt que d’imputer l’échec à la seule volonté individuelle, il faut tenir compte des contraintes biologiques et socio-économiques et favoriser des politiques qui facilitent l’accès à une alimentation de qualité et à des lieux d’activité physique, notamment dans les territoires défavorisés de Nouvelle-Aquitaine et du reste de la France.
Article fondé sur les travaux présentés par Rachel Woods et initialement publié sur The Conversation. Nouvelles d’Aquitaine reprend ici les éléments scientifiques et les chiffres cités par l’auteur.